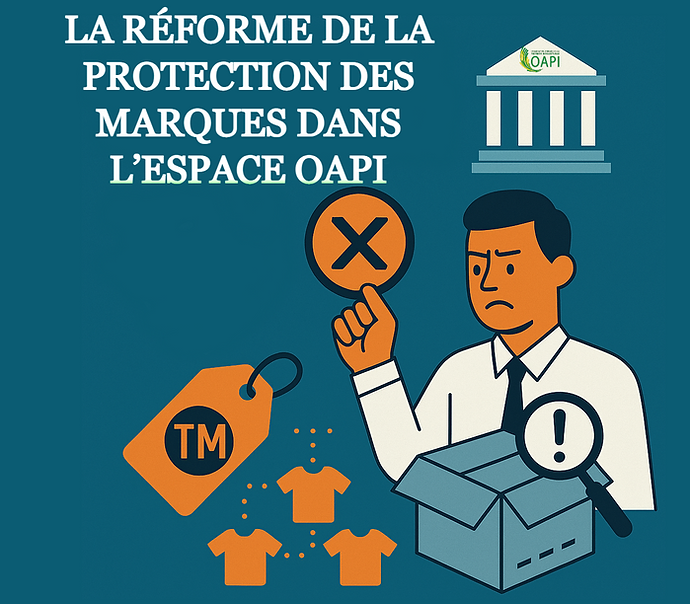
La réforme de la protection des marques dans l’espace OAPI : avancée pragmatique de l'Acte de Bamako
La révision de l'Annexe III de l’Accord de Bangui, intervenue par l’Acte du 14 décembre 2015 dit Acte de Bamako, s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation des législations de propriété industrielle dans les États membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Vingt-quatre ans après sa création et seize ans après la première version de cette Annexe, il devenait impératif d’adapter le droit positif régional aux standards internationaux, aux impératifs de l’économie numérique, et aux enjeux croissants de lutte contre la contrefaçon. Ce texte n’a pas simplement rénové des dispositifs existants, il a surtout instauré un nouveau paradigme : celui d’un droit des marques fondé sur l’exigence de lisibilité, la rigueur procédurale, et la convergence avec les systèmes juridiques les plus avancés, tout en respectant les spécificités africaines.
À la différence de l’Acte de 1999, largement calqué sur le Code de la propriété intellectuelle français et d’inspiration purement civiliste, l’Acte de 2015 manifeste une ambition propre : organiser un droit des marques régional, cohérent, autonome, et partiellement hybridé par des influences de droit international et comparé. En témoignent les innovations relatives à la nature des signes protégeables, à la structure des procédures d’opposition et de contentieux, à la prise en compte de la pratique contractuelle, et à la valorisation des marques collectives. Le présent article analyse cette évolution, en s’efforçant d’en souligner les ruptures, les continuités et les perspectives, à la lumière du droit comparé, du droit international économique et des pratiques jurisprudentielles de l’OAPI et d’ailleurs.
I. Le renouvellement du concept de signe distinctif : vers une protection des marques non traditionnelles
L’Annexe III de l'Accord de Bangui de 1999 définissait la marque de manière restrictive : seuls les signes visibles étaient admis, écartant de facto les signes sonores, olfactifs, tridimensionnels ou mouvants, contrairement aux tendances doctrinales contemporaines. L’Accord de 2015 consacre une définition élargie, ouverte aux « signes visibles ou sonores », et précise les formes admises de manière exemplative : dénominations, dessins, formes, hologrammes, combinaisons de couleurs, images de synthèse, formes caractéristiques du service, etc. (art. 2).
Cette ouverture permet désormais d’intégrer des réalités marketing devenues courantes : le son d’un jingle, la forme spécifique d’un flacon (comme dans l’affaire du flacon Chanel n°5 en droit français), voire des marques en série (families of marks), comme dans la pratique nord-américaine. Ce glissement n’est pas anodin : il marque le passage d’un droit formaliste à un droit fonctionnaliste, où la capacité distinctive prime sur la matérialité du signe.
Toutefois, contrairement au droit de l’Union européenne depuis l’arrêt Sieckmann (CJCE, 12 décembre 2002) ou au système américain fondé sur le Lanham Act, l’Acte de Bamako ne fournit pas de critères spécifiques de représentation graphique ou de reconnaissance sensorielle. L’absence de normes précises sur les conditions de recevabilité des signes non visuels laisse place à une incertitude interprétative, que seule la jurisprudence future de la Commission supérieure de recours pourra clarifier.
II. La rationalisation des procédures à partir de la demande d'enregistrement
L’une des critiques majeures adressées à l’ancien Accord tenait à la faiblesse de ses procédures : absence de division des demandes, défaut de rigueur dans l’examen de fond, manque de transparence sur les oppositions. Le nouvel accord y répond de manière structurée.
D’abord, il introduit la possibilité de division des demandes (art. 17), comme en droit européen (EUTMR art. 44) et dans le Madrid System. Cela permet une gestion tactique des portefeuilles, particulièrement utile en cas d’objection partielle ou de négociation.
Ensuite, si l’Acte de Bamako maintient l’examen à la fois formel et substantiel de la demande, incluant les motifs absolus de refus tels que la déceptivité, la descriptivité et la contrariété à l’ordre public, il innove en créant une nouvelle étape préalable à cet examen au fond : la publication de toute demande d’enregistrement qui lui est régulièrement adressée. Cette nouvelle phase du processus a un impact procédural important en ce qu’elle devient le nouveau point de départ du délai de 3 mois au cours duquel une opposition à l’enregistrement peut être introduite. S’il n’existe pas en droit OAPI de période d’observation des tiers non détenteurs de marques comme cela se fait dans le système français, cette restructuration demeure un tournant méthodologique qui permet à la nouvelle procédure d’opposition de se distinguer de l’ancienne qui s’apparentait plutôt à une procédure d’annulation de l’enregistrement déjà délivré.
Le nouvel Accord introduit également des délais clairs, des règles de régularisation et des normes de publicité accrues. Il renforce l’opposabilité des droits antérieurs, notamment dans les procédures d’opposition (art. 22), en cohérence avec les standards ADPIC (art. 16) et les recommandations de l’OMPI.
Cependant, l’OAPI reste caractérisée par une concentration institutionnelle problématique : elle cumule les fonctions d’instruction, d’enregistrement et de recours (via la Commission supérieure de recours). À la différence de l’EUIPO (recours devant le Tribunal de l’Union), de l’USPTO (recours devant les juridictions fédérales), ou encore de l’Office russe (ROSPATENT), où les recours peuvent être portés devant la Cour d’arbitrage de Moscou, l’OAPI ne prévoit pas de recours juridictionnel externe contre ses décisions. Cette centralisation soulève pour certains des difficultés en matière de transparence et de sécurité juridique, faute de publication systématique des décisions.
III. La densification du contentieux de la propriété des marques
Deux innovations majeures doivent ici être soulignées : L’instauration d’une double compétence en matière d'action en revendication de propriété devant les juridictions nationales et l’évolution de l’ancienne action en radiation vers une action en déchéance.
a) La double consécration de la revendication de propriété
L’article 40 de l’Annexe III de 2015 introduit la possibilité pour le véritable titulaire d’une marque d’engager une action en revendication de propriété devant les juridictions nationales compétentes, s’il établit que l’enregistrement a été fait en fraude de ses droits ou à la loi. Cette action, qui n’existait pas dans l’Acte de 1999, crée une passerelle directe entre la propriété des titres et les juridictions nationales. Elle est inspirée de l’article L. 712-6 du Code français de la propriété intellectuelle, et rejoint les mécanismes d’équité reconnus en droit anglo-saxon (théorie du first-to-use or. first-to-file).
Toutefois, l’Annexe III de 2015 ne fixe aucun délai de prescription pour cette action en revendication de propriété devant les juridictions nationales, contrairement à d’autres annexes du même Accord. Maître FADIKA MADIA, dans son commentaire de l’Annexe III, estime qu’il s’agit probablement d’une omission, dans la mesure où les autres annexes de l’Acte de Bangui de 2015 fixent généralement un délai de trois ans pour ce type d’action. En l’absence de précision textuelle, on doit considérer qu’en droit positif OAPI, l’action en revendication de propriété d’une marque devant les tribunaux étatiques n’est enfermée dans aucun délai, ce qui pourrait générer à terme une insécurité juridique relative. Cette annexe n’étant entrée en vigueur qu’en janvier 2022, il conviendra d’attendre les premières jurisprudences des États membres pour voir quelle orientation sera retenue.
Par ailleurs, la procédure de revendication de propriété devant l’OAPI elle-même, déjà prévue à l’article 5 de l’Acte de 1999, est désormais régie par l’article 16 de l’Acte de 2015. Ce dernier article ne se contente plus de faire un au règlement d’application, mais structure la procédure elle-même et ses éléments de forme. Toutefois, ledit article resserre le délai de revendication de propriété qui était de six mois, à trois mois à compter de la publication de l’enregistrement, probablement afin de favoriser la sécurité juridique et de prévenir les revendications dilatoires.
b) La modification substantielle du régime de la radiation de marque sur décision judiciaire
L’ancienne « action en radiation », prévue par l’article 24 de l’Acte de 1999, disparaît au profit d’une action en déchéance, désormais codifiée à l’article 39 de l’Acte de 2015. Cette action peut être engagée soit en cas d’absence d’exploitation sérieuse de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans, soit en cas d’usage devenu générique ou trompeur, ce qui constitue une innovation notable. La radiation est cette fois-ci instituée comme la conséquence du succès de l'action en déchéance de marque.
En consacrant l’inexploitation comme fondement autonome de la déchéance, l’Acte de 2015 rejoint les systèmes européens (EUTMR art. 58) et américains (Lanham Act § 1127), mais aussi le droit japonais (Trademark Act art. 50) ou encore coréen (Trademark Act art. 119) qui sanctionnent tous l’inaction des titulaires et protègent le marché contre les dépôts dormants. Cette exigence renforce la logique utilitariste du droit des marques : le droit ne protège que ce qui est effectivement utilisé à des fins distinctives.
IV. La quête d’une répression efficace de l'atteinte aux droits
L’Acte de Bamako renforce substantiellement l’arsenal procédural à la disposition des titulaires de droits confrontés à des atteintes à leur marque. Trois axes principaux méritent d’être soulignés : l’action en contrefaçon, la protection douanière et la question de la réparation.
a) Une action en contrefaçon améliorée
Dans sa définition l’article 49 de la nouvelle Annexe III étend l’action en contrefaçon à tout acte portant atteinte à une marque enregistrée et prouvé par tout moyen. Si l'action au fond en contrefaçon est restée relativement inchangée, l'innovation majeure réside dans la systématisation de la possibilité d’une action en référé pour faire cesser l’atteinte, sans attendre l’issue du procès au fond, à l’instar des procédures d’"injunction" dans en droit américain (Lanham Act, §34).
En Afrique francophone, cette réforme est inédite, et pose la question de l’effectivité du recours devant des réalités telles que l’absence de tribunaux spécialisés, l’inégal accès à l’expertise technique et l’incontestable lourdeur des procédures. Seule une jurisprudence volontariste pourra rendre cette innovation efficiente.
b) Une implication des autorités douanières et administratives
L’Acte de 2015 institue expressément à l'Article 66 de son Annexe III, des mesures douanières conservatoires à l’importation ou à l’exportation de produits soupçonnés de contrefaçon. Ce mécanisme, inspiré du règlement UE n° 608/2013 de l’Union européenne, permet de solliciter la suspension de la mise en libre circulation pour éviter l’inondation d'un marché national par une cargaison de produits contrefaisants.
Toutefois, cette mesure est purement préventive et, si elle n’est pas suivie d’une saisie contrefaçon en bonne et dure forme, n’a pas à elle seule d’incidence probante. À la différence du système brésilien (Recife Protocol, 2006), ou du modèle sud-africain (Customs and Excise Act, sec. 113), aucun mécanisme d’échantillonnage ou d’authentification technique n’est en effet prévu.
c) Un encadrement à minima des réparations pécuniaires
Sur la question de l’indemnisation de la victime de contrefaçon, L’article 54 de la nouvelle Annexe III introduit des critères objectifs d’évaluation du préjudice : bénéfices perdus, profits indus, préjudice moral. Cette approche multifactorielle est plus lisible et mieux alignée sur la fonction économique de la marque qui justifie une évaluation extensive du dommage.
Mais L’OAPI se limite à des considérations générales et laisse aux juridictions nationales le soin de fixer les montants, sans cadre unifié ni barème de référence, ou encore somme forfaitaire comme celle prévue par la Directive 2004/48/CE du Parlement Européen .
Conclusion :
L’Annexe III de l'Acte de Bamako marque une transformation substantielle du droit des marques dans l’espace OAPI. Par la reconnaissance de signes non traditionnels, la structuration des procédures, la clarification des actions contentieuses, et l’intégration de standards internationaux, elle réalise une mise à niveau normative objectivement nécessaire.
Toutefois, certaines insuffisances subsistent, notamment l’absence de recours juridictionnel externe, l'incertitude sur certains délais de prescription et le manque d’un cadre technique pour les nouveaux signes. L’avenir de cette réforme dépendra donc largement de sa mise en œuvre administrative, de la production jurisprudentielle future, et de l’évolution du règlement d’application.
Dans une perspective comparative, l’OAPI s’est dotée d’un instrument cohérent et potentiellement influent dans les dynamiques de régionalisation juridique en Afrique. La révision de 2015 constitue donc un socle, non une clôture. Elle appelle une mobilisation interprétative continue et une gouvernance rénovée du droit des marques dans l’espace africain francophone.
Sources juridiques et normatives principales
-
Accord de Bangui :
-
Acte de Bamako du 14 décembre 2015, Annexe III relative aux marques de produits ou de services (entrée en vigueur en janvier 2022).
-
Accord de Bangui du 2 mars 1977 révisé en 1999 (ancienne version de l’Annexe III).
-
-
Textes internationaux et comparés :
-
Règlement (UE) n° 608/2013 concernant la surveillance douanière des produits soupçonnés de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
-
Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle .
-
EUTMR : Règlement sur la marque de l’Union européenne .
-
Lanham Act (États-Unis), 15 U.S.C., notamment sections §34 (injunctions) et §1127 (abandon/non-use).
-
Japanese Trademark Act
-
Korean Trademark Act.
-
Customs and Excise Act (Afrique du Sud).
-
Recife Protocol (Brésil), 2006 .
-
-
Jurisprudence citée :
-
CJCE, Sieckmann, 12 décembre 2002, aff. C-273/00.
-
Louis Vuitton Canada Inc. v. Yang, 2015 (Cour fédérale du Canada).
-
-
Références nationales étrangères :
-
Code de la propriété intellectuelle (France) :
- Article L. 712-6 (revendication de propriété).
- Article L. 716-6 (référé). -
India Commercial Courts Act (2015) et jurisprudence associée.
-
Mécanismes brésiliens et sud-africains (procédures douanières)
-
- Références doctrinales:
- Maître FADIKA MADIA, commentaire et annotation de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé de 2015, 2022, Juriscope.
Besoin d'assistance ou de conseil juridique à propos d'une marque?
_edited_edited.png)